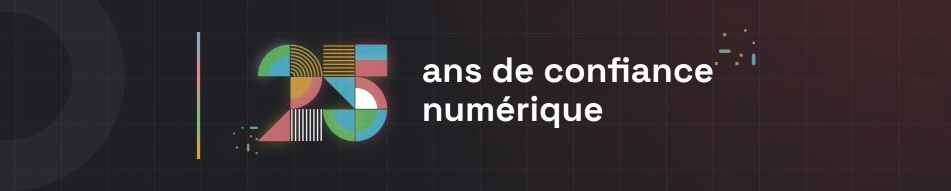La récente controverse autour de WeTransfer — liée à l’ajout dans ses conditions d’utilisation d’une clause perçue qui permettrait l’utilisation des fichiers des utilisateurs pour entraîner des intelligences artificielles — a soulevé une problématique majeure dans le secteur du cloud et du partage de fichiers.
Même si l’entreprise a depuis clarifié et limité cette clause, l’incident met en lumière une réalité préoccupante : la quasi-opacité des conditions d’utilisation des plateformes internationales, rarement lues par les utilisateurs.
Plutôt que de réduire cet épisode à un cas isolé, il invite à une réflexion plus large : dans quelle mesure contrôlons-nous vraiment nos données stratégiques ?
Comprendre la polémique WeTransfer
Cette controverse a provoqué une onde de choc chez les utilisateurs comme chez les experts du numérique. La cause : l’introduction d’une clause ambiguë dans les CGU, laissant entendre que les fichiers pourraient être exploités pour entraîner des modèles d’IA.
Si WeTransfer a ensuite précisé que cela ne concernerait pas les fichiers partagés mais uniquement certains contenus publics, l’épisode souligne une faille de confiance : les utilisateurs ignorent souvent ce que deviennent leurs fichiers une fois envoyés sur ces plateformes.
Pourquoi est-ce si problématique ?
- Popularité et simplicité : WeTransfer est massivement utilisé car gratuit et ergonomique, y compris pour des documents professionnels sensibles (contrats, photos, fichiers clients).
- Flou juridique : dès lors qu’un prestataire se réserve un droit d’accès ou d’exploitation, la frontière entre service et monétisation des données devient floue.
- Manque de transparence généralisé : la plupart des grandes plateformes n’expliquent pas clairement le cycle de vie des données ni leur destination réelle après l’upload.
Conséquences potentiellement graves
- Risque d’utilisation ou d’accès non autorisés à des informations sensibles ;
- Possibilité d’usage non consenti pour entraîner des IA tierces ;
- Impact sur la confidentialité, la propriété intellectuelle ou l’image des entreprises concernées.
Gardez le contrôle sur vos fichiers partagés
Partagez, modifiez, annotez et envoyez vos contenus sensibles dans un environnement sécurisé.


Pourquoi la souveraineté numérique et la protection des données sont désormais indispensables ?
Confier ses fichiers à une plateforme internationale revient à accepter qu’ils transitent par plusieurs juridictions et puissent être soumis à des lois étrangères.
L’affaire WeTransfer relance un débat plus large : qui contrôle réellement nos données et que deviennent-elles une fois hébergées hors d’Europe ?
Exemple concret : le Cloud Act américain
Le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), adopté en 2018 aux États-Unis, permet aux autorités américaines de réclamer l’accès aux données détenues par des entreprises américaines, même si elles sont hébergées en dehors des États-Unis.
Conséquences pour les entreprises européennes :
- Des acteurs comme Microsoft, Google ou Amazon peuvent être contraints de fournir ces données aux autorités américaines ;
- Selon la CNIL, près de 80 % des données des entreprises françaises transitent par des services soumis à une législation extraterritoriale, créant une vulnérabilité juridique majeure (source : CNIL, 2023) ;
- Une simple utilisation d’un service cloud américain peut donc exposer des fichiers stratégiques (plans industriels, R&D, dossiers clients) à des demandes judiciaires étrangères.
La souveraineté numérique comme réponse
L’affaire WeTransfer ne se limite pas à une clause contractuelle mal interprétée : elle révèle une problématique bien plus profonde. Avec des données circulant en permanence entre différentes juridictions, la question du contrôle et de la protection devient centrale. Qui, en définitive, décide du sort de nos fichiers stratégiques une fois qu’ils quittent nos serveurs ?
Un besoin croissant de maîtrise et de transparence
La souveraineté numérique consiste à garantir qu’une organisation garde la main sur l’ensemble du cycle de vie de ses données :
- Localisation : où sont stockées les informations sensibles ? Sur un territoire soumis à une juridiction protectrice (RGPD) ou exposé à des législations extraterritoriales comme le Cloud Act américain ?
- Accès : qui peut consulter, exploiter ou exiger la remise de ces données, et sur quelles bases légales ?
- Usage : dans quel but ces données peuvent-elles être réutilisées (analyse, entraînement de modèles IA, exploitation) ?
Cette maîtrise dépasse la simple conformité réglementaire : elle devient un enjeu stratégique de résilience et de compétitivité. Une organisation qui perd le contrôle de ses données s’expose à des risques économiques (espionnage industriel), juridiques (sanctions, litiges) et réputationnels (perte de confiance des clients ou des partenaires).
Pourquoi la souveraineté numérique devient incontournable ?
- Explosion des volumes de données sensibles
La digitalisation massive des processus métiers (santé, industrie, finance, administrations) a entraîné une croissance exponentielle des données critiques stockées dans le cloud. Selon IDC, plus de 65 % des entreprises européennes externalisent leurs données stratégiques, accentuant la dépendance à des prestataires dont le cadre juridique n’est pas toujours aligné avec leurs obligations.
- Un contexte géopolitique tendu
Les rivalités technologiques entre grandes puissances et les tensions géopolitiques (États-Unis/Chine, guerre en Ukraine) rappellent que les données sont désormais un enjeu de souveraineté économique et diplomatique. Les lois extraterritoriales comme le Cloud Act ou la loi chinoise sur la cybersécurité permettent à des États d’accéder à des données hébergées en dehors de leur territoire, créant des risques juridiques majeurs pour les entreprises européennes.
- Des obligations réglementaires renforcées
Au-delà du RGPD, l’Union européenne accélère avec de nouvelles initiatives comme le Data Act ou le futur schéma de certification EUCS. L’objectif est clair : rapatrier la maîtrise des données critiques au sein d’un cadre européen et limiter leur exposition aux législations étrangères.
- Un enjeu de confiance et d’image
Une violation de données ne se résume pas à une sanction financière : elle peut fragiliser durablement la réputation d’une organisation et briser la confiance de ses clients ou de ses usagers. Dans des secteurs comme la santé, la défense ou les services publics, cette confiance est vitale.
La souveraineté numérique est une condition de pérennité pour les entreprises et administrations manipulant des données sensibles. Elle ne consiste pas uniquement à “choisir une solution locale”, mais à repenser la gouvernance des données : où elles circulent, qui peut y accéder, et comment éviter leur exposition à des risques juridiques ou géopolitiques.
SecNumCloud : label de confiance
Le référentiel qui garantit le plus haut niveau de sécurité pour la protection de vos données sensibles.


Le rôle de la qualification SecNumCloud
En France, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) délivre la qualification SecNumCloud, qui impose :
- Un contrôle total de la chaîne technique par un acteur français ou européen souverain ;
- Une protection renforcée contre les législations extraterritoriales ;
Aujourd’hui, seules quelques solutions disposent de cette qualification, représentant une garantie maximale pour les organisations manipulant des données stratégiques (secteurs santé, défense, services publics).
Quelles alternatives françaises pour un partage de fichiers souverain ?
Face à ces enjeux, de plus en plus d’organisations cherchent des alternatives aux plateformes internationales. Les solutions françaises qualifiées SecNumCloud apparaissent comme des réponses crédibles : elles garantissent un hébergement local, une stricte conformité au RGPD et une protection renforcée face aux législations étrangères.
Oodrive Work illustre cette approche : développée et opérée en France, cette solution collaborative associe fonctionnalités avancées et exigences de sécurité maximales, tout en étant certifiée selon les standards les plus élevés. Elle offre ainsi aux entreprises et administrations une maîtrise totale de leurs flux numériques et une réponse concrète aux préoccupations de souveraineté.
Il convient néanmoins de souligner que toutes les offres souveraines ne sont pas équivalentes. La maturité des solutions, leur certification et leur capacité à répondre aux besoins collaboratifs d’une organisation doivent être soigneusement évaluées. La réflexion ne consiste pas à stigmatiser les acteurs internationaux, mais à ouvrir un débat éclairé sur la maîtrise des données et les choix responsables à faire dans un contexte numérique en pleine mutation.