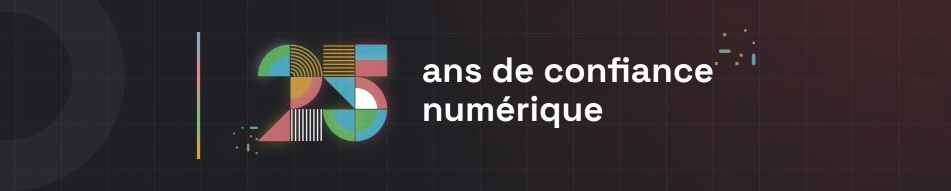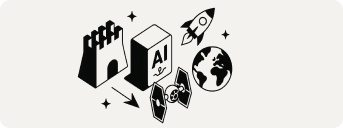Synthèse de l’article
- La souveraineté numérique n’est pas un isolement mais la capacité à choisir ses dépendances technologiques et à transformer l’interdépendance en levier de puissance.
- L’Europe reste une puissance normative (RGPD, DMA, AI Act) mais souffre d’une faiblesse industrielle qui limite l’impact de ses régulations.
- La French Tech illustre un fort potentiel, avec 18 000 start-up et une dynamique d’innovation soutenue, mais un financement trop concentré à Paris freine son équilibre territorial.
- Trois fronts décideront de la souveraineté européenne : l’IA, les semi-conducteurs et l’indépendance juridique face aux lois extraterritoriales tel que le Cloud Act
Il fut un temps où le mot « souveraineté » sonnait comme une relique du passé. Trop associé à l’idée de frontières, de protectionnisme ou de repli, il paraissait incompatible avec la mondialisation triomphante et l’interconnexion planétaire. Pourtant, au milieu de la décennie 2020, il est revenu au cœur du débat stratégique, notamment dans le domaine technologique. Parce que la donnée est devenue un levier de puissance, parce que les plateformes structurent l’économie mondiale, parce que l’intelligence artificielle, le cloud ou les semi-conducteurs sont désormais des enjeux de sécurité nationale, la question n’est plus de savoir si l’Europe doit se doter d’une souveraineté numérique, mais comment elle doit la penser, la construire et l’exercer.
Souveraineté ne veut pas dire isolement
L’un des grands malentendus du débat actuel est de confondre souveraineté et autarcie. Beaucoup de responsables politiques européens ont cru qu’il suffisait de freiner les géants américains pour faire émerger des champions continentaux. Depuis vingt ans, l’Union européenne a multiplié les enquêtes, les amendes et les régulations contre les GAFAM. Elle a même modifié sa doctrine en profondeur en adoptant, avec le Digital Markets Act (DMA), une régulation ex ante inédite dans l’histoire du droit de la concurrence européen. Et pourtant, le bilan est maigre : en 2025, l’Europe ne compte toujours pas de géant du numérique à l’échelle planétaire, à l’exception notable d’ASML dans les semi-conducteurs. Sa recherche-développement est reléguée derrière celle des États-Unis et de la Chine, et son tissu industriel reste dépendant d’architectures matérielles conçues ailleurs et de briques logicielles développées outre-Atlantique.
Cette situation ne signifie pas que la souveraineté soit impossible. Elle montre simplement ce qu’elle n’est pas : une indépendance totale, immédiate et universelle. Les Européens continueront à utiliser des smartphones américains assemblés en Asie, et les infrastructures de cloud ou d’intelligence artificielle reposeront encore longtemps sur des technologies venues d’outre-mer. La souveraineté consiste non pas à nier ces interdépendances, mais à les choisir, à les organiser, à en faire des leviers plutôt que des vulnérabilités. Elle suppose de savoir où placer les lignes rouges, quelles dépendances sont acceptables et lesquelles ne le sont pas.
Cette tension n’est pas propre à l’Europe. Même les États-Unis, berceau des géants du numérique, y sont confrontés. L’US Navy elle-même a récemment renoncé à changer de prestataire cloud, faute de solution alternative crédible à Microsoft sans coûts exorbitants ni risque opérationnel. Si même la première puissance mondiale est contrainte de composer avec ses dépendances technologiques, il est illusoire d’imaginer une Europe totalement indépendante. La question n’est donc pas l’autonomie absolue, mais la maîtrise stratégique.
Le paradoxe européen : puissance normative, faiblesse industrielle
L’Union européenne a su, ces dernières années, faire de la régulation un instrument d’influence mondiale. Le RGPD a inspiré des législations sur la protection des données sur tous les continents. Le DMA et le Digital Services Act ont imposé un nouveau cadre de concurrence et de responsabilité aux plateformes. L’AI Act adopté en 2025 est la première tentative globale de régulation de l’intelligence artificielle. Cette « puissance normative » est une force, mais elle ne suffit pas. Sans relais industriels puissants, la régulation se transforme en contrainte pour les acteurs européens plutôt qu’en levier stratégique.
L’épisode récent de Nextcloud, qui a retiré sa plainte contre Microsoft pour abus de position dominante faute de réponse de la Commission européenne, illustre ce paradoxe. L’Europe dispose des outils pour défendre son marché intérieur, mais elle hésite à les utiliser pleinement. Cette timidité juridique sape l’ambition souveraine et laisse perdurer des positions dominantes qui freinent l’émergence d’alternatives crédibles. Être souverain, c’est précisément savoir mobiliser tous les instruments disponibles — régulation, commande publique, fiscalité, soutien à l’innovation — pour structurer un écosystème compétitif.
French Tech : les preuves d’un potentiel
Sur ce plan, la France offre un laboratoire instructif. La publication du premier état des lieux complet de la French Tech en 2025 dresse le portrait d’un secteur en pleine mutation. Avec 18 000 start-up actives et 450 000 emplois directs créés, dont 45 000 concentrés dans les entreprises du Next 40 et du French Tech 120, l’écosystème français démontre sa capacité à générer de la valeur et de l’emploi. La croissance se diffuse désormais au-delà de l’Île-de-France : une start-up sur deux naît en région, et certaines filières — comme le spatial en Occitanie ou la greentech en Nouvelle-Aquitaine — deviennent des pôles d’excellence à part entière.
Les financements suivent cette dynamique : 5,8 milliards d’euros ont été investis entre janvier et septembre 2025, principalement dans l’intelligence artificielle, la deeptech, la santé et les technologies vertes. Mieux encore, la collaboration entre start-up et grands groupes s’intensifie : en quatre ans, leur nombre a été multiplié par dix, et la part des jeunes pousses françaises dans ces partenariats est passée de 45 % à 71 %. L’innovation n’est plus un satellite de l’économie traditionnelle, elle en devient un moteur.
Mais ce tableau flatteur cache des fragilités. Le financement reste très concentré : 47 % des opérations sont réalisées en Île-de-France, et seules 7 % des levées de fonds en IA bénéficient aux entreprises régionales, alors qu’elles représentent 44 % des créations. Cette asymétrie menace l’émergence de champions hors de la capitale et risque de creuser une fracture territoriale dans l’économie de l’innovation. Le défi pour la décennie à venir sera d’articuler croissance, financement et industrialisation à l’échelle de l’ensemble du territoire.
Trois fronts décisifs pour la souveraineté européenne
Au-delà de ces constats, la bataille pour la souveraineté numérique se joue désormais sur trois fronts stratégiques qui détermineront la place de l’Europe dans la compétition mondiale.
1. L’intelligence artificielle comme levier de puissance.
L’AI Act marque une étape historique : pour la première fois, un acteur tente de structurer un cadre mondial pour l’IA. Mais la régulation doit s’accompagner d’une ambition industrielle. Aujourd’hui, moins de 5 % du marché mondial de l’IA est européen, et la majorité des modèles utilisés dans nos entreprises sont américains ou chinois. Sans investissement massif, l’Europe risque de devenir un simple marché pour les technologies conçues ailleurs, incapable d’en influencer l’évolution.
2. Les semi-conducteurs, colonne vertébrale de l’économie numérique.
La souveraineté ne peut exister sans maîtrise matérielle. Le Chips Act européen, avec ses 43 milliards d’euros d’investissements, vise à relocaliser une partie de la production de semi-conducteurs. C’est un pas décisif, mais le chemin reste long. L’Europe dépend encore des capacités de production asiatiques (TSMC, Samsung) et américaines (Intel). Or, sans contrôle sur ces composants stratégiques, aucune autonomie réelle n’est possible dans le cloud, l’IA ou la cybersécurité.
3. L’extraterritorialité du droit, bataille juridique et politique.
La législation américaine (Cloud Act, FISA) impose à ses entreprises de fournir des données aux autorités, même si elles sont hébergées en Europe. Cette ingérence potentielle constitue une vulnérabilité majeure pour les États comme pour les entreprises. La jurisprudence récente de la CJUE rappelle que le transfert de données vers de tels fournisseurs est contraire au droit européen. Cela pousse à développer des solutions de cloud de confiance et des initiatives comme GAIA-X. Mais la question demeure : l’Europe saura-t-elle transformer ses principes juridiques en puissance stratégique ?
Sortir des illusions, choisir nos dépendances
Il est temps d’admettre que la souveraineté absolue est une illusion. Dans un monde interdépendant, la puissance se mesure à la capacité d’orienter ses dépendances, d’imposer ses standards, de protéger ses données, d’investir dans ses infrastructures critiques et de créer les conditions d’émergence de ses propres champions. Cela suppose une coordination stratégique entre les politiques industrielles, les régulations, les choix budgétaires et les alliances technologiques.
La bonne nouvelle, c’est que l’Europe n’est pas démunie. Elle dispose d’un écosystème d’innovation dynamique, d’une puissance normative reconnue, d’un tissu industriel solide et d’une expertise scientifique de haut niveau. Elle a les moyens de redevenir une puissance technologique globale. Ce qui lui manque encore, c’est une volonté collective d’articuler ces atouts dans un projet cohérent.
Être souverain dans un monde interconnecté ne signifie pas se couper des autres. Cela signifie refuser la dépendance subie et construire une interdépendance choisie. Cela signifie utiliser la régulation comme levier de puissance, et non comme simple bouclier. Cela signifie transformer l’innovation en influence, l’industrie en indépendance, et l’Europe en acteur stratégique à part entière.
Le XXIᵉ siècle sera numérique, ou il sera dominé. L’Europe a désormais toutes les cartes en main pour en être l’un des protagonistes majeurs. Reste à savoir si elle aura la lucidité et le courage de les jouer.